130 ans après sa condamnation, nouvelle étape dans la réhabilitation d'Alfred Dreyfus
Le 29 mai 2025, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une proposition de loi historique qui élève Alfred Dreyfus, injustement condamné pour trahison en 1894, au grade symbolique de général de brigade. Ce geste fort, porté par le député Charles Sitzenstuhl du groupe Ensemble, vient réparer une injustice qui a profondément marqué l’histoire de la République. Décryptage avec Philippe Oriol, spécialiste de "l'affaire Dreyfus" et directeur de la Maison Émile-Zola Musée Dreyfus.
 La condamnation d'Alfred Dreyfus est un symbole fort de l'antisémitisme du XIXe siècle en Europe et en France. © DR
La condamnation d'Alfred Dreyfus est un symbole fort de l'antisémitisme du XIXe siècle en Europe et en France. © DRSpécialiste de "l'affaire Dreyfus" et directeur de la maison Émile-Zola Musée Dreyfus, Philippe Oriol souligne que les discours antisémites d'aujourd'hui rappellent le "discours de l'époque. Un discours antisémite mais, au-delà de ça, un discours xénophobe".
Aujourd’hui, en lui accordant à titre posthume le grade de général, la République française reconnaît non seulement les torts qui lui ont été infligés, mais aussi le courage et la dignité d’un homme resté fidèle à son pays, même lorsqu’il a été trahi. "Si il y a vraiment quelqu'un qui incarne et les valeurs de la résistance et les valeurs de la République, c'est justement Alfred Dreyfus", assure Philippe Oriol. Ce geste n’efface pas l’histoire, mais il lui redonne un peu de justice.
La place de l'Église et du nationalisme dans l'antisémitisme du XIXe siècle
Alfred Dreyfus naît en 1859 dans une famille juive alsacienne, douloureusement marquée par la défaite de 1870 et l’annexion de l’Alsace-Moselle. Polytechnicien brillant, patriote sincère, Dreyfus gravit les échelons de la hiérarchie militaire jusqu’à devenir capitaine. Mais sa carrière est brisée brutalement en 1894 : accusé à tort d’avoir livré des secrets militaires à l’Allemagne, il est condamné pour haute trahison, dégradé publiquement et déporté en Guyane.
S'il y a vraiment quelqu'un qui incarne les valeurs de la résistance et les valeurs de la République, c'est justement Alfred Dreyfus
Derrière cette affaire judiciaire se cache une réalité bien plus sombre : celle d’un antisémitisme profondément enraciné dans la société française de la fin du XIXe siècle. L’affaire Dreyfus n’aurait pas existé sans la haine envers les juifs, diffusée aussi bien dans les milieux nationalistes que dans certains courants intellectuels et religieux. Le journal La Croix, alors dirigé par des Assomptionnistes, se targuait à cette époque d’être "le journal le plus anti-juif de France".
Des penseurs comme Gobineau théorisent l’inégalité des races, tandis qu’une frange de la gauche socialiste nourrit une hostilité envers les juifs, perçus comme symboles du capitalisme. Même la présence modeste de juifs en France (moins de 100 000 sur 39 millions d’habitants) suffisait à nourrir la rhétorique de "l’invasion".
Mieux vaut tard que jamais
Selon Philippe Oriol, "on a remis Dreyfus dans la logique de sa carrière". Lorsque Dreyfus est finalement gracié en 1899 puis réhabilité en 1906, "un article de loi, qui a été rigoureusement le même que celui qui a été voté à l'unanimité et qui visait à rendre à Dreyfus cette dernière justice, a été bloqué par les deux figures politiques que sont le général Picard et Georges Clémenceau". Pourtant, il ne retrouvera jamais le rang auquel sa carrière militaire l’aurait conduit sans cette injustice.
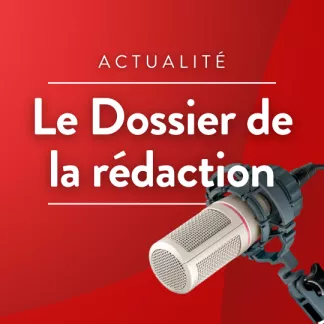

Chaque matin à 7h10, les journalistes de RCF décryptent un sujet d'actualité en profondeur, dans la Matinale RCF.




