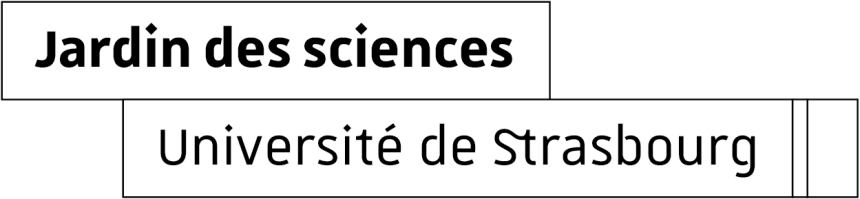Epique époque : Algorithmes, contenus ciblés... y êtes-vous sensibles ?
L'internaute qui consulte des médias en ligne finit invariablement par être confronté à des idées ou des produits qui seront conforme à ses opinions et à sa représentation du monde. Ces bulles d'informations sont-elles uniquement de notre fait ? Comment les outils informatiques déterminent-ils le contenu qui plaît ?
Pour mieux comprendre en quoi ces algorithmes sont efficaces, il nous faut examiner leur conception, mais aussi les biais cognitifs et autres mécanismes émotionnels et cérébraux qu'ils provoquent en nous.
Sébastien BALLESTA, maître de conférences, laboratoire de neurosciences cognitives, et adaptatives, centre de primatologie de Strasbourg
Thomas BORAUD, directeur de Recherche CNRS, directeur de l'Institut des Maladies Neurodégénératives, Université de Bordeaux
Célina TREUILLIER, docteure en informatique, Human-IST Institute, Université de Fribourg (Suisse)
Quels domaines sont touchés par les algorithmes de recommandation ?
 © Jardin des Sciences
© Jardin des SciencesQue sont les systèmes de recommandation : comment ça fonctionne, où est-ce qu'on les retrouve ?
Où ? Est-ce qu’il y a une logique marchande, quel genre de logique régit ces systèmes de recommandation ? Peut-on apporter de la diversité dans ces algorithmes ? Comment ces algorithmes ont-ils été créés ?
Systèmes de recommandation (SR) retrouvés partout (Amazon, Netflix, Spotify,..). Tous confrontés à ces systèmes tous les jours (même si on en a pas forcément conscience).
SR apparus par nécessité : très grande quantité d’informations disponible, nous sommes incapables de la traiter dans son entièreté.

Rôle des SR : filtrer l’information, mais de façon intelligente = personnalisation des contenus recommandés
Objectif scientifique → optimiser la précision de ces systèmes, c'est-à-dire leur capacité à identifier le contenu effectivement intéressant pour un utilisateur, c'est-à-dire correspondant à ces préférences ou besoins.
Pour faire cela, on distingue 2 approches principales (+ approches hybrides) :
Filtrage basé sur le contenu
Filtrage collaboratif
D’un point de vue business, l’objectif est surtout de garder l’utilisateur actif sur la plateforme, de façon à ce qu’il consomme le plus d’items possible (pour faire du chiffre).
Néanmoins, il a été démontré que la précision seule ne suffit pas à satisfaire les utilisateurs. Certaines autres dimensions sont désormais prises en compte lors du développement des SRs, comme la diversité ou la nouveauté.
Enfin, comme on aborde le sujet de l’accès à l’information, important de citer un type de SRs particulier : les systèmes de recommandation de news. Sont appliqués pour la recommandation des contenus informatifs (agrégateurs de news, version en ligne des médias traditionnels…).
Doivent répondre à certaines spécificités :
Durée de vie très limitée des news
Turn-over important des news
Rôle démocratique puisque participent à l'accès à l'information, et potentiellement à la construction des opinions sur certains sujets.
2. Sur quels ressorts psychologiques ces systèmes de recommandation sont-ils crées ?
- Biais cognitifs
Comme l’illustre cette illusion d’optique, notre perception du monde peut ne pas correspondre à sa réalité. Si nos sens peuvent être biaisés, pourquoi pas nos facultés cognitives ?
C’est ce qu’on appelle les biais de cognition, la recherche en psychologie cognitive en ont identifié un très grand nombre.
Est-ce qui concerne notre prise de décisions, nous pouvons illustrer notre propos par le choix suivant
Quel est l’intérêt évolutif des biais cognitifs ? Ces biais sont-ils partagés par d’autres espèces ?
09
Depuis peu, nous recherchons aussi ces biais de cognition chez les animaux, cela nous permet justement de savoir dans quelle mesures sont-ils propre aux humains et si on les trouve chez d’autres espèces animale, est ce qu’ils sont plus présent chez des espèces soumises à des contraintes socio-écologiques plus forte que d’autres. Nous avons identifié au Centre de Primatologie de l’Université de Strasbourg, en collaboration avec l’équipe de Thomas Boraud à Bordeaux que des macaques montraient les biais de cognition mentionné précédemment (aversion à la perte). Nous cherchons actuellement si des espèces ayant, par exemple, de plus grands risques liés à leurs environnements sociaux ou à la pression des prédateurs ont des bias d’aversion à la perte plus ou moins marqué.
Structures neuronales :
Les réseaux de la prise de décision permettent de peser différentes options en fonction des expériences passées et des récompenses attendues. La prise de décision repose sur un équilibre entre exploration (découverte de nouvelles options) et exploitation (choix de l’option la plus rentable connue). Ils sont constitués des aires corticales frontales et préfrontales (notamment PFC, PFC et CCA), des noyaux gris centraux et du thalamus).
Ils résultent de l'évolution du système nerveux chez les vertébrés et une étude comparative permet de mieux comprendre comment il se sont complexifiés au cours de l'évolution et les nouvelles capacités auxquelles leur développement donne accès. Il est à noter que ce n'est pas un processus linéaire, mais qu'il existe des évolutions parallèles notamment chez les oiseaux.
3. Ces systèmes de recommandation comportent-ils des risques ? (Célina)
Enfermement, polarisation, bulles de filtres, une dualité de ces systèmes : ils sont utiles et nécessaires et pour autant ils peuvent être problématiques. Que pouvons-nous faire pour résoudre ces problèmes-là ?
En suivant les approches décrites plus tôt, les SRs comportent en effet des risques. En recommandant du contenu toujours similaire aux consommations précédentes de l’utilisateur, ils participent à leur enfermement au sein de bulles informationnelles, ou bulles de filtre. Au sein desquelles ils n’accèdent qu’à une quantité limitée de l’information.
→ Participe au phénomène de polarisation (qui n’est pas le résultat du filtrage de l’information uniquement, cercle social de l’individu a aussi un rôle à jouer)
Polarisation = phénomène complexe, abordé par des experts de disciplines variées + définition
SRs présentent donc une certaine dualité : nécessaires pour filtrer l’information, mais doivent permettre d'accéder, ou du moins d’être confrontés, à une certaine diversité.
Pour répondre aux effets négatifs de ces SRs, une solution intuitive consiste à apporter de la diversité dans les recommandations, et de nombreuses études menées en ce sens.
Néanmoins apport de la diversité sont pas toujours ceux attendus : peut renforcer la polarisation, ou bien n’avoir aucun effet.
Pour garantir un effet positif de l’apport en diversité, déjà besoin de comprendre la façon dont les utilisateurs se comportent pour accéder à l’information en ligne (à partir de données d’interaction). Puis adapter les approches de recommandation.
En particulier, travail sur une approche de triple optimisation : précision, diversité, équité.
Dans tous les cas, soulève des questions éthiques auxquelles il faut veiller. Surtout, nous ne cherchons pas, en tant qu’informaticien, à modifier les opinions (aucune légitimité). Mais plutôt à rétablir une prise de décision éclairée de la part des utilisateurs.
4. Même en connaissant nos biais de sélection, irions-nous contre ?
Equilibre entre exploitation (on répète les mêmes comportements) et exploration (essayer des nouvelles pistes).


Épique Époque,
Regards croisés et illustrés pour mieux comprendre les défis de notre temps :
une nouvelle série de podcast sur la science !
Des conférences réalisées par le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg un jeudi par mois, dans son Planétarium.
Tout au long de ce cycle de conférences, plusieurs spécialistes reviennent sur les grands défis de notre temps à travers un format inédit : des prises de parole d'une vingtaine de minutes chacune, suivies d'un temps d'échange, le tout illustré en direct par Hélène Bléhaut, et animé par Paul Fonteneau.
Vous avez loupé ces conférences ou n’avez pas pu vous y rendre ?
RCF Alsace y était pour vous ! Retrouvez chacune de ces conférences sur le site internet RCF Alsace.